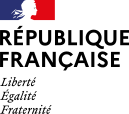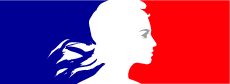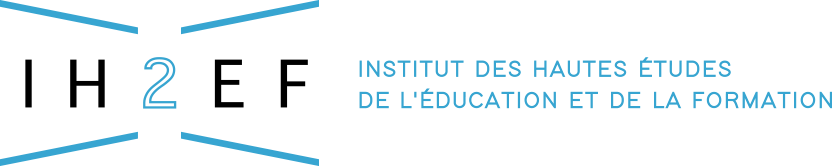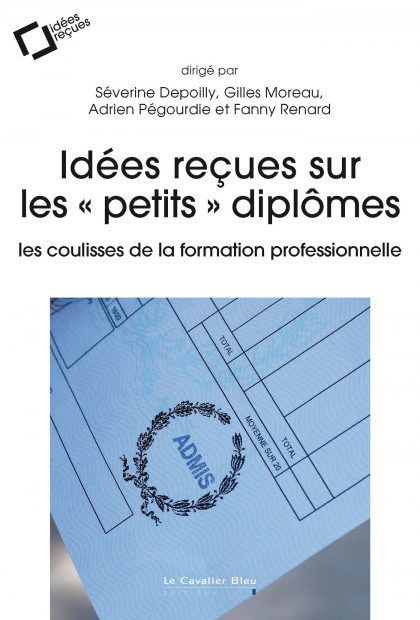
À propos de : Idées reçues sur les "petits diplômes", les coulisses de la formation professionnelle, dirigé par Séverine Depoilly, Gilles Moreau, Adrien Pégourdie et Fanny Renard.
Éditions Le cavalier bleu, Paris, 2023, 184 pages.
- Séverine Depoilly est maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Poitiers et membre du Groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines (GRESCO)
- Gilles Moreau est professeur des universités en sociologie à l’université de Poitiers et membre du GRESCO
- Adrien Pégourdie est maître de conférences en sociologie à l’université de Limoges et membre du GRESCO
- Fanny Renard est maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Poitiers et membre du GRESCO.
Cet ouvrage est publié avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du programme "Savoirs professionnels en formation et en territoires" (SAPRO).
Recension d'ouvrage réalisée par Fabienne Saunier, proviseure dans l'académie d’Aix-Marseille et experte associée à l’IH2EF.
Contexte d'édition
Cet ouvrage a été publié en avril 2023 aux éditions Le Cavalier Bleu. Il appartient à la collection "Idées reçues - Gresco" (groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines) qui apporte des éclairages scientifiques sur les grands enjeux sociétaux d’aujourd’hui. Cet ouvrage est dirigé par Séverine Depoilly, Gilles Moreau, Adrien Pégourdie et Fanny Renard, également membres du Gresco. D’autres auteurs ont collaboré à cet ouvrage : Amélie Beaumont, Joachim Benet Rivière, Charline Brandy, Sophie Denave, Nicolas Divert, Henri Eckert, Prisca Kergoat, Nadia Lamamra, Marie-Hélène Lechien, Emmanuel de Lescure, Maryse Lopez, Fabienne Maillard, Fanette Merlin, Sylvie Monchatre et Sophie Orange.
Idées clés et positionnement dans un contexte
Cet ouvrage se compose de trois parties :
- un "petit" diplôme, c’est quoi ?
- un "petit" diplôme pour qui ?
- un "petit" diplôme pour quoi faire ?
Des articles courts constituent chaque partie et interrogent certaines idées reçues sur les "petits" diplômes en s’adossant aux résultats de la recherche dans le champ de la sociologie, au contexte historique et sur des résultats statistiques et des rapports institutionnels.
L’introduction pose le cadre d’ensemble de la problématique, les représentations stéréotypées feraient de ces "petits" diplômes une voie réservée aux élèves exclus de la "compétition scolaire" (cursus bac général, universités ou grandes écoles) alors que la réalité n’est pas aussi tranchée que cela. En effet, comme le rappellent les auteurs, un diplôme n’est pas une catégorie statistique et s’inscrit dans des trajectoires biographiques. De plus, les politiques publiques et la régulation du marché du travail influent également sur la valeur ajoutée d’usage du diplôme.
La première partie, "un "petit" diplôme c’est quoi ?", s’articule autour de six articles courts et traite des idées reçues suivantes :
- le bac est devenu un "petit" diplôme ;
- les "petits" diplômes ont toujours été petits ;
- c’est le ministère de l’Éducation nationale qui crée seul les diplômes ;
- dans les "petits" diplômes il n’y a pas de culture générale ;
- l’apprentissage c’est pour les "petits" diplômes ;
- les "petits" diplômes c’est mieux à l’étranger.
Les auteurs relèvent ainsi que le diplôme du baccalauréat (contenus et résultats) doit être contextualisé à chaque époque depuis sa création en fonction des attendus de la société (la comparaison d’un niveau entre époques différentes n’est pas significative).
De plus, il existe maintenant trois filières du baccalauréat : le bac général, le bac technologique et le bac professionnel. Or, comme le soulignent les auteurs, le sens et l’usage social du diplôme varient d’un groupe à l’autre. Concernant plus particulièrement le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), l'histoire de ce diplôme et les représentations connexes (de sa création à nos jours) sont corrélées non seulement à l’évolution de l’organisation du travail et des besoins en main d’œuvre mais aussi à la création du bac professionnel en 1985. L’idée reçue qu’il n’y a pas de culture générale dans les "petits" diplômes est discutée par les auteurs au regard des attendus de l’entreprise dans le cas d’une insertion professionnelle et du souhait de certains élèves de poursuivre en section de brevet de technicien supérieur (BTS). Le cas de la formation par apprentissage, qui serait favorable et facilement accessible aux apprenants choisissant de s’orienter vers un diplôme professionnel, est analysé par les auteurs qui démontrent que cette idée reçue ne correspond pas à la réalité de nos jours. En effet, l’aspiration par le haut de l’apprentissage introduit un nouveau sas de sélection qui opère un déplacement du niveau de recrutement qui n’est pas favorable aux plus jeunes apprenants.
La deuxième partie de l’ouvrage, "un "petit" diplôme pour qui ?" est constituée de cinq articles :
- les "petits" diplômes sont préparés par des "petits" profs ;
- les "petits" diplômes c’est pour ceux qui ne peuvent pas aller en général ;
- aux hommes la mécanique et les transports, aux femmes l’administration et le soin ;
- tout le monde peut avoir un "petit" diplôme ;
- les diplômes agricoles c’est pour les enfants d’agriculteurs.
L’idée reçue est que les enseignants de lycée professionnel (PLP) sont des "petits" profs est rapidement balayée par les auteurs. En effet, ces derniers sont assujettis, en termes de politique publique, à la réussite d’élèves sortant de collège (avec un parcours scolaire souvent chahuté) que cela soit en termes d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études.
La problématique de l’orientation scolaire choisie ou subie est au cœur du second article, les auteurs interrogent la procédure d’affectation selon les différents diplômes de la voie professionnelle, certains présentent des taux de pression très importants (notamment des CAP), ce qui ne permet pas aux élèves les plus fragiles d’accéder à ces formations. L’insertion professionnelle des filles plus souvent scolarisées dans des formations colorées tertiaire, malgré leur performance scolaire plus élevée que celle des garçons, est interrogée par les auteurs tout comme la présence exclusive d’enfants agriculteurs dans les formations délivrées par le ministre de l’Agriculture (observation d’une dépaysannisation).
La dernière partie de l’ouvrage intitulée, "un "petit" diplôme pour quoi faire ?" s’articule autour de huit thématiques.
Sur la question plus particulière de la formation par apprentissage, les auteurs discutent du fait qu’elle reste une voie d’insertion professionnelle privilégiée pour certains secteurs (dont le bâtiment), mais affiche pour le secteur du tertiaire notamment un taux d’emploi beaucoup plus bas combiné à un processus de sélection des futurs apprentis s’opérant en amont. Par ailleurs, s’appuyant sur les travaux de Bourdieu et Passeron (corrélation enseignement professionnel et processus de reproduction sociale), les auteurs posent la question de la finalité de l’enseignement professionnel en faveur des élèves de lycée professionnel : apprendre un métier ou à occuper une position subalterne dans la hiérarchie sociale ?
Concernant la poursuite des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur (dont la part n’a cessé de grandir depuis 2010), les auteurs interrogent cette perspective au regard de la fragilité de ce public à obtenir le diplôme (cantonné à certaines spécialités de BTS davantage favorables pour les bacheliers professionnels). Les auteurs démontrent que la régulation du marché du travail passe aussi par la hiérarchisation des diplômes, le cas du secteur de la petite enfance en est emblématique.
Intérêts spécifiques
Dans le contexte actuel de la réforme de la voie professionnelle et des objectifs de politique publique (déclinés en douze mesures) assignés aux professionnels de cette voie de formation visant à lutter contre le décrochage scolaire, à qualifier les futurs étudiants en faveur de leur poursuite d’études et/ou d’insertion professionnelle, la lecture de cet ouvrage apporte des éclairages très intéressants non pas en termes d’opérationnalisation mais en termes d’éléments d’analyse sociologique et historique. Les professionnels de cette voie de formation (chefs d’établissements, inspecteurs, PsyEN, enseignants, etc.) pourront y trouver des éléments pour nourrir leurs réflexions et leurs regards sur les diplômes et les élèves de l’enseignement professionnel. Il rappelle aussi, et contrairement à des idées reçues, que la création des diplômes professionnels n’est pas le résultat de la seule initiative du ministère de l’Éducation nationale, mais qu’elle s’opère avec le concours bien réel, quoique variable selon les domaines, des branches professionnelles (dans le cadre des commissions professionnelles consultatives), générant ainsi des arrangements plus ou moins consensuels entre les objectifs éducatifs du ministère et les finalités économiques des potentiels employeurs.
La liste des références bibliographiques permet au lecteur d’approfondir certaines thématiques.